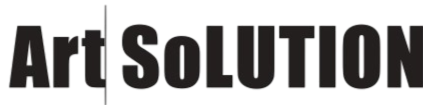Warren Levy art - Le collage comme langage : la méthode Erró
Erró, de son vrai nom Guðmundur Guðmundsson, est une figure majeure de l’art contemporain. Né en Islande en 1932, il s’est imposé à partir des années 1960 par une pratique singulière du collage. Chez lui, cette technique ne se limite pas à l’assemblage d’images. Elle devient un véritable langage visuel.
L’artiste collecte des images issues de la bande dessinée, des médias, de la publicité ou de la propagande. Ces éléments, découpés ou numérisés, sont ensuite réorganisés dans des compositions saturées. Chaque collage raconte une histoire. Erró utilise le choc visuel comme outil narratif.
Une technique entre manuel et numérique
Le processus de création d’Erró a évolué avec le temps. Dans les premières décennies, il réalisait ses collages à la main, en juxtaposant papiers et magazines. À partir des années 2000, il intègre l’outil numérique. Il scanne, redimensionne et superpose les images, qu’il imprime avant de les transposer sur toile. Ce collage préparatoire devient la matrice d’une œuvre peinte, souvent exécutée par des assistants.
Cette double approche, manuelle et digitale, renforce la densité de ses compositions. Le résultat final donne une impression de débordement, volontairement étouffante. Chaque détail compte. Rien n’est laissé au hasard.
Un langage critique et autonome
Erró ne crée pas des images simplement pour séduire. Ses œuvres contiennent une critique du monde contemporain. Il dénonce la guerre, la surconsommation, le pouvoir politique ou encore l’uniformisation des cultures. Il le fait en détournant les codes visuels connus du public.
Le spectateur est ainsi confronté à une forme de chaos organisé. Il ne s’agit pas seulement de regarder, mais de lire, d’interpréter, de questionner. Le collage devient ici un langage autonome, capable de penser le monde en images.
L’esthétique de la saturation
La saturation visuelle est l’un des fondements esthétiques d’Erró. Il refuse le vide. Chaque espace de ses tableaux est habité. Cette accumulation est une réponse directe à l’excès d’images dans nos sociétés modernes.
Face à ses œuvres, le regard circule sans repos. L’œil est forcé de naviguer entre les figures, les signes, les références. Cette surcharge n’est pas décorative : elle est le miroir d’un monde en crise. Elle invite à la réflexion, au déchiffrement, à la vigilance.